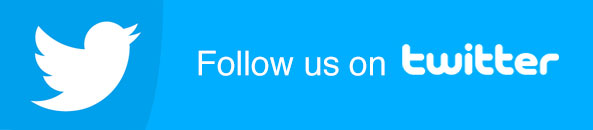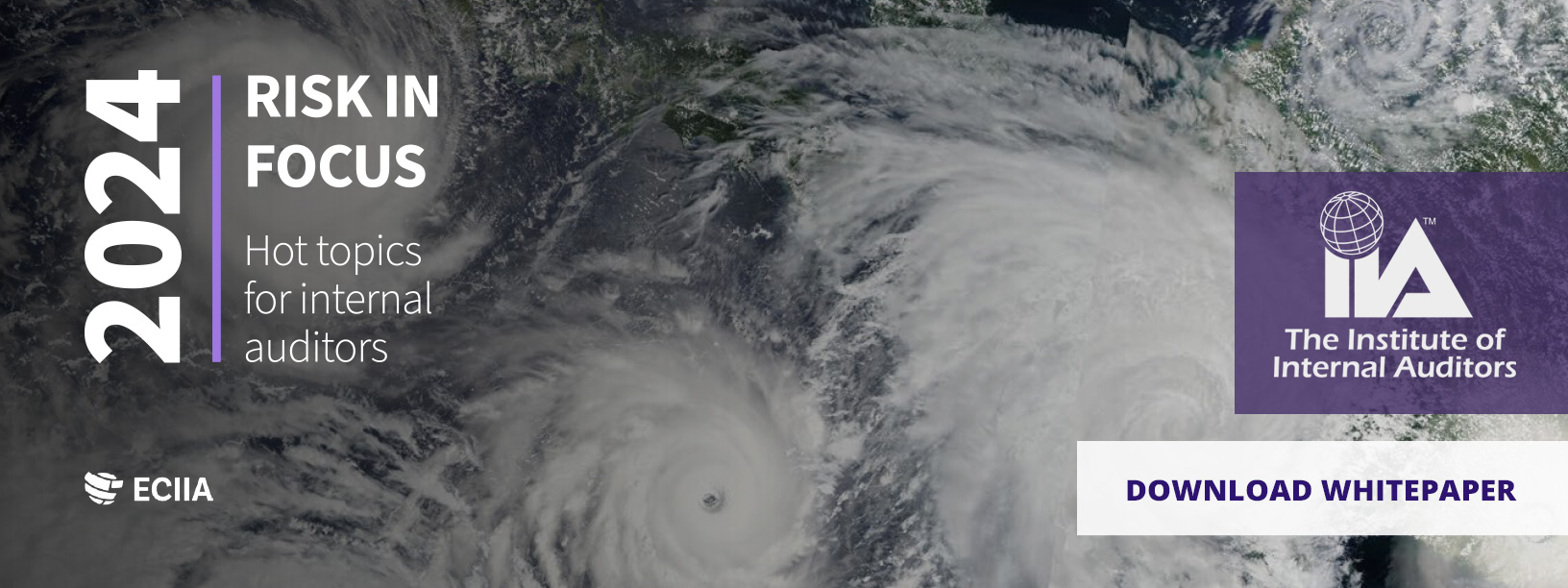Un tax shift à l’impôt des sociétés
Le tax shift est un mouvement giratoire consiste à diminuer le coût salarial global au travers d’une baisse des cotisations sociales et d’une revalorisation des bas salaires nets. Le point d’arrivée de ces mesures est donc une amélioration de la compétitivité. Le financement de ces mesures ressortit, quant à lui, plutôt à un assemblage de mesures diverses qu’à une empreinte décisive. Il s’agit de prélèvements accrus sur la consommation et, dans une moindre mesure, sur les revenus du capital. On remarque incidemment que contrairement à une re-globalisation des revenus, qui était la philosophie fiscale de 1962, c’est désormais un « dual tax system » qui s’impose, c’est-à-dire un système de taxation progressive pour les revenus professionnels et de taxation proportionnel pour les autres revenus (mobiliers, immobiliers et divers) d’une personne physique. Comment poursuivre ce tax shift à l’impôt des sociétés ?
Aujourd’hui, le problème conjoncturel n’est plus l’accès au capital, mais la relance de l’investissement et de l’emploi. En effet, nous traversons une crise de la demande, qui se traduit elle-même par un contexte déflationniste et récessionnaire. C’est donc par la stimulation de la consommation intérieure et de l’investissement productif que l’économie peut être relancée, d’autant que le stock de capital vieillit. Il faut désormais imaginer une nouvelle fiscalité. C’est possible en appliquant le principe des intérêts notionnels (c’est-à-dire la déduction d’une charge non décaissée à l’impôt des sociétés) aux investissements et à l’emploi. Pour les investissements, il faut en réduire le coût d’usage. Une solution intuitive pourrait être de permettre des amortissements accélérés. Malheureusement, cette mesure n’entraîne qu’un effet de trésorerie puisqu’elle ne permet à l’entreprise qu’à anticiper la déduction fiscale (et donc l’économie d’impôt) associée à l’amortissement. Cet effet de trésorerie est négligeable en période de taux d’intérêt nuls. Il faut donc l’écarter.
Une mesure offensive s’impose alors : il s’agirait d’amortir fiscalement les biens pour un montant supérieur à leur coût d’acquisition. Par exemple, un investissement de 100 pourrait être amorti pour un montant exemplatif de 130. Comme pour les intérêts notionnels, la différence de 30 ne correspondrait pas à un décaissement effectif : il s’agirait uniquement de déduire un montant de 30 à travers l’amortissement, c’est-à-dire par un jeu d’écritures fiscales. L’intérêt serait, pour l’entreprise, d’obtenir un avantage fiscal supplémentaire correspondant à ce surcroît d’amortissement (30), multiplié par le taux actuel d’ISOC (34 %), soit 10. Le gain de 10 réduirait le coût effectif de l’investissement qui passerait de 100 à 90 (en sus de l’effet de l’amortissement). Seuls les nouveaux investissements seraient éligibles à cette mesure incitative. Bien sûr, on argumentera que seules les entreprises qui paient des impôts pourraient bénéficier de cette mesure, d’autant que les pertes fiscales ne sont déductibles que des bénéfices futurs. Une solution serait alors d’imaginer un remboursement d’impôt effectif correspondant à l’avantage fiscal. Il serait plafonné en montant et dans le temps. Une telle mesure s’inscrirait dans la nécessaire ré-industrialisation du pays. Elle pourrait même être modulée en fonction du type d’investissement que le législateur veut favoriser et être déclinée différemment selon les régions.
Ceci étant, d’aucuns argumenteront, à juste titre, que des entreprises pourraient détruire des emplois par des investissements de mécanisation des tâches. C’est pour cette raison qu’il faut une mesure similaire pour l’emploi. La même logique pourrait, dès lors, être appliquée aux salaires du personnel nouvellement embauché : un salaire brut de 100, déjà déductible de l’ISOC pourrait l’être pour un montant supérieur à 100. L’entreprise bénéficierait ainsi d’une réduction immédiate d’impôt qui abaisserait le coût salarial sans toucher à la sécurité sociale ou à l’indexation.
Ce type de mesure, qui suppose bien sûr une base taxable positive, serait un lointain écho aux mesures Maribel, imaginées en 1981 pour stimuler l’emploi, au moyen d’une réduction des charges patronales pour les entreprises qui avaient recours à des travailleurs manuels et spécifiquement tournées vers l’exportation.
Tant pour l’investissement que pour les frais salariaux, la réduction d’impôt devrait être affectée à une réserve indisponible qui ne pourrait pas servir au paiement des dividendes. Elle contribuerait ainsi à l’autofinancement des entreprises.
On le sait : une réforme de l’ISOC devient urgente. Ce n’est évidemment plus le passif (c’est-à-dire le financement) mais l’actif (c’est-à-dire l’investissement et l’emploi) des entreprises qu’il faut favoriser. Au reste, lorsque j’avais imaginé les intérêts notionnels en septembre 1999, l’économie était en haute conjoncture et ce n’est plus le cas aujourd’hui. La réforme de l’ISOC doit impérativement s’inscrire dans le contexte de croissance basse et surtout de désinflation. Dans cet environnement, il est inutile de stimuler le financer des entreprises. Si une faible reprise se confirme, tout va se jouer dans les prochains trimestres. En mettant en œuvre les deux mesures défendues dans cette contribution, on ferait basculer la fiscalité dans une logique keynésienne.
Bruno Colmant