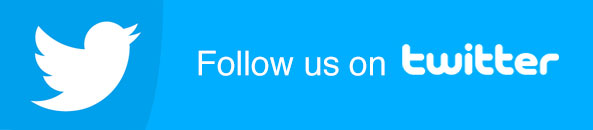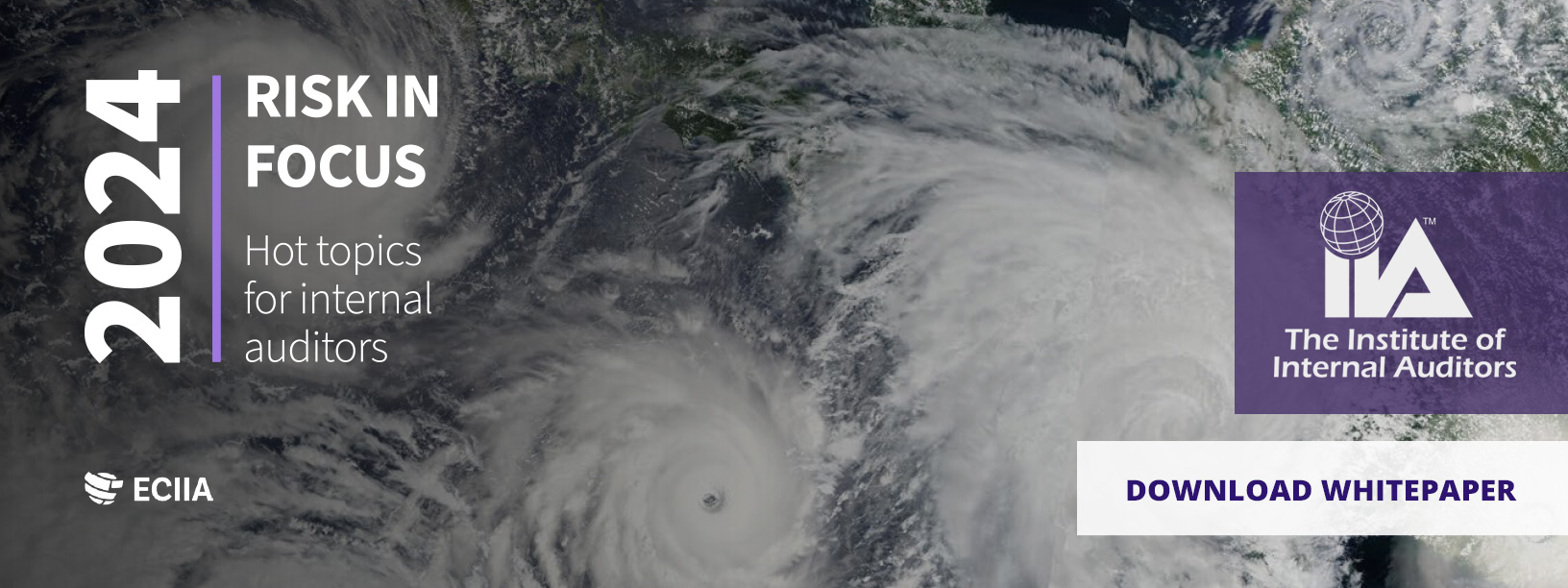Bruno Colmant
S’il y a une erreur fatale à commettre en économie, c’est de postuler que son état est pérenne. C’est ainsi que de nombreux commentateurs se saisissent d’un contexte déflationniste et de taux d’intérêt bas pour en postuler l’immuabilité, voire d’affirmer que nous entrons dans une stagnation séculaire, c’est-à-dire un état de morosité économique qui durerait un siècle. Outre le fait que les auteurs de ces sentencieuses affirmations ne seront plus là pour en attester le bien-fondé, quelle naïveté que d’imaginer une stabilité des paramètres économiques ! A terme, la croissance revient toujours.
Je voudrais consacrer cette contribution au niveau des taux d’intérêt. Ceux-ci sont actuellement bas sous l’effet conjugué des programmes d’assouplissements quantitatifs (ou quantitative easing) et de mesures autoritaires prises par les banques centrales.
L’assouplissement quantitatif consiste à réescompter des dettes publiques auprès des banques centrales. Ces dernières deviennent donc des créanciers des Etats dont les dettes servent de gage à la monnaie créée. Il ne s’agit donc aucunement d’injecter directement de la monnaie dans l‘économie réelle, mais de soulager la ponction sur l’épargne publique que les Etats devraient exercer pour financer l’accroissement de leur endettement. Techniquement, les Etats et les banques centrales échangent leurs passifs, puisque la dette publique est celui des États tandis que la monnaie est inscrite au passif des banques centrales. Ces programmes d’assouplissement illustrent incidemment la fiction de l’indépendance des banques centrales, dont l’image n’a plus de valeur de réalité.
Ces assouplissements quantitatifs conduisent à une baisse des taux d’intérêt, puisque la monnaie devient plus abondante et donc moins chère. Inversement, on peut expliquer ce phénomène par le fait que la pression haussière exercée par les banques centrales sur le prix des obligations d’Etat fait baisser leur rendement, donc le taux d’intérêt.
Par ailleurs, les banques centrales imposent de manière régalienne des taux d’intérêt négatifs afin de stimuler la consommation intérieure et extérieure (au travers d’une baisse du cours de change). Les principaux bénéficiaires des taux d’intérêt bas et du refinancement de dettes publiques sont les Etats, dont l’endettement a cru de près de 50 % depuis la crise de 2008.
La BCE a confirmé que les taux d’intérêt à court terme (c’est-à-dire sous son contrôle) resteront bas. La question est de savoir si le constat de taux d’intérêt à long terme bas est durable. Nul ne peut préjuger de l’avenir, mais j’en doute. A cet égard, il faut rappeler que le taux d’intérêt est l’addition de trois composantes : un taux d’intérêt réel (destiné à compenser le renoncement à la liquidité du prêteur), une protection contre l’inflation future anticipée et un risque de crédit associé à la qualité de solvabilité de l’emprunteur.
Examinons ces trois composantes
Le taux d’intérêt réel reflète la loi de l’offre et de la demande de monnaie. Son niveau est donc conditionné par les besoins de capitaux. Ceux-ci sont bas dans un contexte récessionnaire, mais une stabilisation de la croissance va certainement entraîner leur remontée. Cette augmentation pourrait se conjuguer aux besoins de renouvellement d’infrastructures publiques qui seront financés par l’emprunt public, suscitant une hausse du taux d’intérêt réel.
Le retour de l’inflation est, quant à lui, inéluctable puisqu’il est affirmé par les banques centrales. Certes, la théorie quantitative de la monnaie, qui postule que le niveau des prix est proportionnel à la quantité de monnaie en circulation, est contrariée par différents phénomènes, tels que le vieillissement de la population, la baisse des gains de productivité et l’endettement public. Mais, sauf à croire que nous entrions dans de nouveaux paradigmes économiques, il arrivera un moment où l’injection monétaire associée aux programmes d’assouplissement quantitatifs va tracter l’inflation. Cette pression inflationniste sera combinée à la croissance de l’endettement public dont le refinancement va exiger une création monétaire accrue. Bien sûr, l’inflation fait peser un risque d’auto-alimentation. Mais elle parait s’imposer comme une conséquence, voire un débouché, inéluctable du réescompte monétaire des dettes publiques.
Pourquoi une intuition d’inflation alors que de nombreux économistes évoquent le spectre de la déflation (ou stagnation) séculaire? Parce que la création de monnaie ex-nihilo (avec des billets qui ne deviennent que des créances sur d’autres billets, ceci rappelant l’expression de l’économiste Jean-Baptiste Say (1767-1832) pour lequel « la monnaie n’est qu’un voile »), telle que mise en œuvre par les banques centrales, est une traite sur l’avenir dont le remboursement deviendra incertain. Les récentes mesures créent donc de l’argent sans créer de capital.
Certains économistes avancent même que la crise bancaire, étatique et économique est le résultat d’une période caractérisée par un excès de désinflation. Cette période, qualifiée de « grande modération » et qui serait étalée de 1985 à 2005, aurait tiré profit d’une expansion des zones de commerce (au travers de la globalisation) et d’une accessibilité à des poches d’emploi à bas coûts pour masquer la réalité du remboursement des dettes privées et publiques. L’expansion de la demande n’a pas débouché sur une crise d’inflation parce que les occidentaux ont trouvé dans leurs déficits commerciaux l’offre nécessaire à son absorption.
Au reste, on devra se poser la question de savoir comment les autorités monétaires européennes ont pu imposer en même temps des objectifs d’inflation extrêmement bas (2 % sur une base annuelle) et autoriser des États-membres d’augmenter leur endettement public dans des proportions telles que la manière la plus intuitive d’en diminuer le poids est justement une diminution de la valeur relative de la monnaie par l’inflation, ce que les banques centrales entendent désormais stimuler.
Enfin, le véritable risque reste celui qui est associé à la solvabilité des débiteurs, c’est-à-dire des Etats, ainsi que l’ancien économiste en chef du FMI l’a récemment rappelé. Aujourd’hui, les banques centrales se substituent aux prêteurs privés pour assurer le refinancement des dettes publiques. Mais je subodore qu’à un moment, les marchés financiers vont s’extraire de la torpeur d’une disparition du risque souverain pour s’interroger lucidement sur les capacités de remboursement de certains pays surendettés (Japon, par exemple) ou dont l’épargne domestique ne suffit plus à assurer le refinancement de la dette (Espagne, Portugal et Italie, par exemple, dans la zone euro). Le risque de crédit va donc se concrétiser quand les banques centrales devront tempérer, voire stabiliser, le refinancement des Etats. Les plus faibles seront confrontés à la nécessité d’augmenter leur taux d’intérêt pour répondre aux exigences de préteurs internationaux qui deviendront méfiants. Cette situation sera d’ailleurs peut-être à l’origine d’une nouvelle crise souveraine dans la zone euro dont la stabilité et l’homogénéité m’ont toujours parues suspectes.
La combinaison de ces trois éléments me conduit donc à l’intuition que le contexte de taux d’intérêt à long terme bas est circonstanciel. Quand les taux d’intérêt augmenteront-ils ? Et comment : par vagues, répliques sismiques ou de manière plus linéaire, monotone et graduelle ? En une fois ou au terme d’une longue agonie économique ? Quel est l’événement, peut-être infime, qui déclenchera des effets en chaîne ? Cela n’a aucune importance.
Si mon intuition se confirme, que serait alors le scénario économique des prochaines années ? Ce pourrait être une stagflation (ou recessflation), c’est-à-dire une combinaison de stagnation économique, affectée d’un chômage persistant, et d’inflation croissante. Les économies occidentales y ont déjà été confrontées dans les années septante. A l’époque, les prêteurs à taux fixe ont subi un brutal appauvrissement. Certes, la stagflation ne serait aucunement l’affolement de cette décennie maudite mais elle pourrait revêtir une certaine réalité. Au reste, Christine Lagarde, la Présidente du FMI, avait déjà affirmé en juin 2014 que c’était le principal danger des pays développés.
Je suis conscient que cette intuition de stagflation ne repose pas sur des bases quantitatives avérées. Mais il faut être lucide: la stagnation économique est constatée tandis que l’inflation est souhaitée. Dans la théorie keynésienne, l’accroissement de monnaie en circulation n’est inflationniste que si la capacité de production et la quantité de main-d’œuvre sont employées à plein, ce qui n’est pas le cas. Dans cette théorie, la coexistence de chômage et d’inflation est suspecte, car les deux facteurs sont antinomiques. Mais les années septante ont démontré qu’on peut subir des tensions inflationnistes en période de crise de la demande.
Et puis nos économies sont surendettées. Sauf en période de guerre totale, la dette des pays développés n’a été aussi élevée, ainsi que le FMI. Pour absorber un surendettement public, l’histoire recense de nombreuses solutions dont les extrémités civilisées sont la répudiation de dettes ou un choc inflationniste. Le choix inflationniste a été postulé par les banques centrales. Il devra être poursuivi. La répudiation de dettes me semble peu probable car le système bancaire et les banques centrales elles-mêmes en seraient pulvérisées. Cette stagflation entrera donc en résonnance avec des problèmes de solvabilité de certains États. La véritable question est savoir si nous aurons le temps d’utiliser l’arme de l’inflation pour ajuster l’endettement public dans un contexte de récession. Une course contre le temps a commence.
L ‘auteur Bruno Colmant est membre de l’Académie Royale de Belgique, Docteur en Economie Appliquée (ULB) et Master of Science de l’Université de Purdue (Etats-Unis). Il enseigne la finance appliquée et l’économie à la Solvay Business School (ULB), à la Louvain School of Management (UCL), à l’ICHEC, à la Vlerick Business School et à l’Université de Luxembourg. Sa carrière est à la croisée des secteurs privés, publics et académiques.
Economie : le spectre des années septante
11 mai 2016