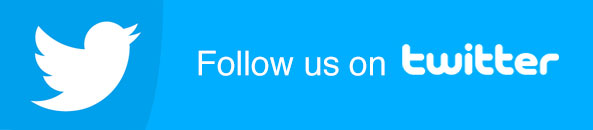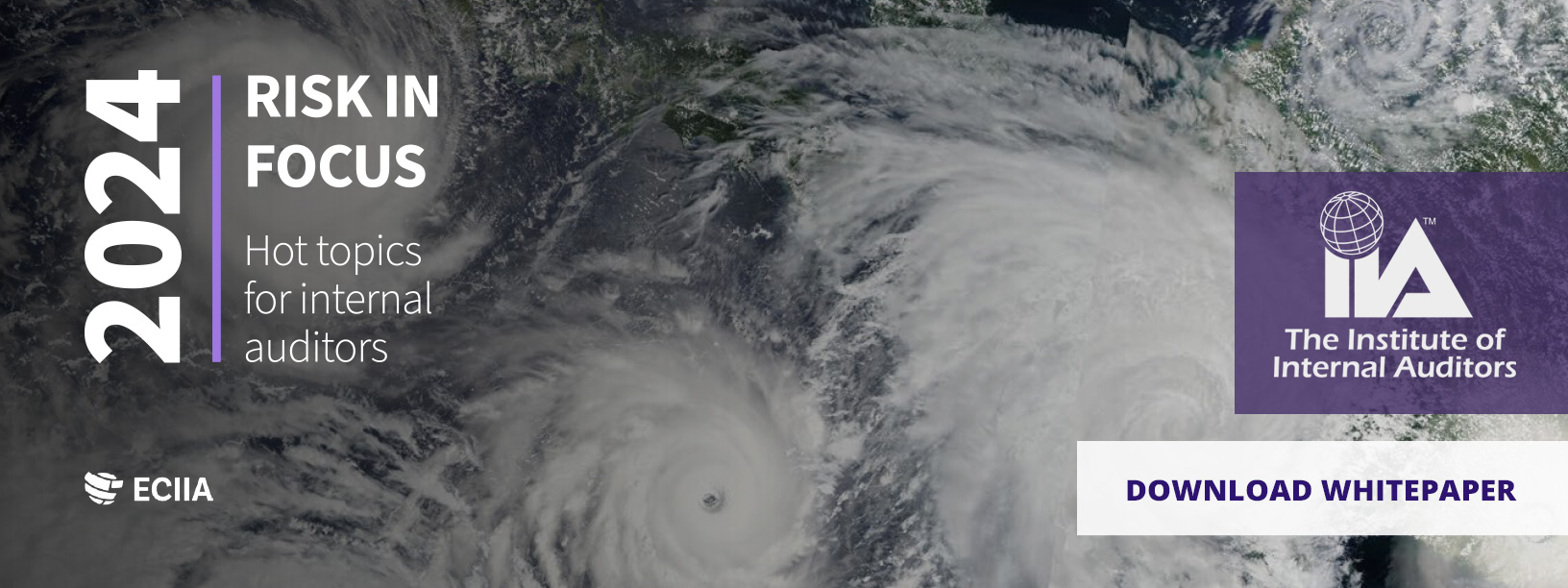Bruno Colmant
Alors que l’économie américaine a repris sa croissance et que la Federal Reserve envisage une normalisation des taux d’intérêt, une rafale de statistiques et prévisions émanant du FMI et de la Banque Centrale Européenne (BCE) nous confrontent à une incontournable réalité : l’économie ne reprend pas suffisamment vite. Certes, les taux de croissance sont positifs, mais médiocres. Et l’indice principal de la reprise économique, à savoir l’anticipation des achats et des investissements, c’est-à-dire le taux l’inflation, est revu à la baisse, malgré les gigantesques injections de liquidités opérées en Europe par la BCE.
Tardivement, la BCE s’est engagée dans des mesures monétaires non conventionnelles (qualifiées d’assouplissement quantitatif) qui consistent à acheter des obligations souveraines pour un montant global de 60 milliards d’euros jusqu’en septembre 2016. Les statuts de la BCE interdisent de financer directement des Etats, ce qui l’amènerait à en devenir le comptoir d’escompte, mais, en réalité, les obligations souveraines concernées ne transitent que fugacement dans des bilans bancaires avant d’être achetées par la BCE. Parallèlement à ces mesures, la BCE impose un taux d’intérêt négatif sur les dépôts bancaires qui lui sont confiés afin de décourager la thésaurisation.
Pour comprendre ces mesures, il faut savoir que la monnaie est à la fois un stock et un flux. La BCE fournit un stock de monnaie, tandis que les banques commerciales créent un flux monétaire par la mécanique des dépôts et des crédits. Quand la vélocité de ce flux diminue, la BCE doit la compenser par la création d’un stock de monnaie additionnel.
Les mesures prises par la BCE ont donc permis de fluidifier les circuits monétaires. Pourtant, elles restent temporairement sans effet sur la croissance, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord la création monétaire reste coagulée dans les bilans bancaires sans transmission suffisamment rapidement à l’économie réelle sous forme de crédits. En effet, l’économie souffre d’une crise de la demande : la consommation et l’investissement sont insuffisants pour tracter la demande de crédits alors que des facteurs objectifs sont favorables (un euro plus faible, des produits pétroliers moins onéreux, des taux d’intérêt bas, etc.). Ensuite, l’assouplissement quantitatif européen est, par nature, moins efficace que celui qui fut mis en œuvre par la Federal Reserve américaine, car, aux Etats-Unis, le financement des autorités publiques et des entreprises s’effectue directement au travers des marchés financiers, sans passer par les bilans bancaires. La transmission d’un assouplissement à l’économie réelle y est donc plus rapide et efficace.
Ceci laisse supposer que la BCE va devoir prolonger ou amplifier cette monumentale création monétaire. L’excédent de dettes publiques, elles-mêmes en croissance, sera partiellement transformé en offre de monnaie. La création monétaire sera donc alimentée par l’endettement public. Dans l’hypothèse probable où l’assouplissement monétaire est amplifié, le bilan de la BCE croîtra au rythme du refinancement des Etats eux-mêmes.
C’est le contraire de la conviction allemande qui repose sur le financement de l’endettement public par de l’épargne déjà constituée, et non pas au travers de la création de monnaie. La logique allemande est que la création monétaire déprécie cette dernière et qu’il n’est pas cohérent d’altérer ce signe de confiance. C’est incidemment à ce niveau que se situe le cœur de la crise de la zone euro, à savoir le manque de consensus sur les modalités de la politique monétaire entre les pays dont les devises ont été unifiées. On distingue, au niveau européen, deux courants de pensées. Pour certains, une politique d’inflation minimale devient un objectif de référence, avec son corollaire de politique léthargique, voire déflationniste, caractérisée par un chômage élevé. Pour d’autres, l’inflation ne devrait pas être un obstacle tant qu’elle n’atteint pas des niveaux inquiétants.
Mais la véritable question est de savoir comment on s’extrait de cette création monétaire : sans reprise d’une croissance vigoureuse, on ne peut aucunement imaginer un relâchement de l’assouplissement monétaire. En d’autres termes, lorsque la BCE sera arrivée au terme de cet assouplissement quantitatif, il est peu probable qu’elle demande le remboursement des obligations souveraines qu’elle aura accumulées. Ces obligations seront remplacées par d’autres titres qui seront émis à ce moment. Si on transpose l’opération américaine à l’Europe, ce refinancement permanent durera 5 ans, jusqu’en 2020.
Dans le cas inverse, il en découlerait une immédiate hausse des taux d’intérêt. Or une hausse des taux d’intérêt contrarierait la croissance et, surtout, pénaliserait les finances publiques au travers de charges d’intérêt plus lourdes. C’est pour cette raison que l’aboutissement de l’assouplissement quantitatif ne peut se concevoir qu’exclusivement dans un contexte d’une hausse de la croissance et de l’inflation. Mais cette simultanéité de taux d’intérêt bas et d’inflation est hasardeuse car les taux d’intérêt, tels qu’établis par les marchés, incorporent une prime destinée à compenser l’inflation anticipée.
Il est donc plausible que les prochaines années soient caractérisées par une « répression financière », c’est-à-dire des mesures coercitives destinées à obliger les banques de détail et les entreprises d’assurances-vie à financer les Etats à un taux d’intérêt artificiellement bas. Au reste, c’est déjà le cas au travers de réglementations qui exonèrent les institutions financières à couvrir la détention d’obligations souveraines par des charges en capitaux actionnariaux (Bâle III, Solvency II). D’ailleurs, de manière cynique, on peut se demander si les États n’ont pas fait un calcul en deux, voire trois temps, qui consiste à baisser les taux d’intérêt au plus bas, afin de refinancer leurs dettes à des conditions exorbitantes tout en pouvant les escompter auprès des banques centrales, avant de voir l’inflation déprécier ces mêmes dettes et/ou permettre leur rachat à des conditions avantageuses, et d’appauvrir ses citoyens par un impôt inflationniste lancinant. Est-ce un scénario improbable ? Non, il ne faut pas l’exclure, d’un point de vue strictement théorique. Et lorsque l’inflation surgira, elle causera un appauvrissement insidieux mais aussi un défi à surmonter pour la population. Ce sera une sorte d’impôt implicite dont l’Etat pourra rejeter la responsabilité politique de la cause.
Le pire serait évidemment que l’économie européenne ne reprenne pas et que les dettes publiques continuent inexorablement à s’élever en proportion du PIB. La BCE serait alors sollicitée de manière inéluctable pour refinancer des Etats, incapable d’en assurer le financement auprès des institutions financières locales ou étrangères. Le risque d’insolvabilité des Etats migrerait alors vers la BCE dont le bilan servirait à consolider une part croissante de l’endettement public. Ce serait évidemment un pas vers une étatisation insidieuse des banques commerciales dont le contrôle prudentiel a d’ailleurs été transféré à la BCE. On remarque d’ailleurs que l’interdépendance de la gestion des États, des banques commerciales et de la BCE s’est accrue dans des proportions qui auraient été impensables, il y a quelques années.
Du rôle de gardien de la monnaie, la BCE endosserait la responsabilité de la stabilité des dettes publiques. Ce serait la BCE qui devrait absorber, de manière résiduelle, les effets de la crise économique dans son bilan, au travers du refinancement des Etats. La BCE deviendrait même l’outil essentiel de sortie de la crise des dettes souveraines. Et c’est le cauchemar de Mario Draghi car cette situation signifierait inéluctablement une rupture d’adhésion de certains pays du Nord à la monnaie unique.
Le cauchemar de Mario Draghi
19 septembre 2015